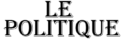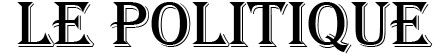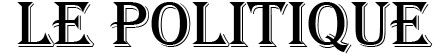
Réduire la période d’indemnisation, c’est réduire le temps dont disposent les plus précaires pour se former, avec le risque de les enfermer dans une trappe à sous-qualification.
Très attendu, les mécanismes de la réforme de l’assurance-chômage ont été présentés aux partenaires sociaux lundi 21 novembre par Olivier Dussopt, ministre du Travail, après son adoption par le parlement quelques jours plus tôt.
C’est un projet contracyclique qui a été exposé, avec pour idée principale de corréler la durée d’indemnisation des chômeurs avec le cycle économique. Ainsi, en période de croissance économique la durée d’indemnisation sera-t-elle plus courte qu’en période de récession en partant du principe que cela demande moins de temps pour retrouver du travail quand l’économie se porte bien.
En prenant cette mesure, le gouvernement poursuit deux objectifs : assurer l’équilibre financier du système d’assurance-chômage et favoriser la baisse du chômage structurel (pour lequel la conjoncture économique n’est pas en cause). Depuis 2009, en effet, le système d’indemnisation chômage est déficitaire avec une prévision de retour à l’équilibre pour fin 2022.
Quant au chômage structurel, il est mesuré entre 7 et 8 % des actifs en France, proche de la moyenne de la zone euro, tandis qu’il est aux alentours de 5 % dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Cette réforme part du présupposé qu’une durée d’indemnisation trop longue serait désincitatif au retour à l’emploi. En économie, il s’agit de ce que l’on appelle un aléa moral : les individus bénéficiant de l’indemnisation feraient un calcul coût-avantage et verraient un avantage à bénéficier de l’allocation chômage sans travailler plutôt que de chercher ou d’accepter un emploi. Autrement dit, cela ne vaudrait pas le coup de travailler vu le trop faible revenu supplémentaire que l’on peut espérer. Par cette réforme, le ministre du Travail table sur 100 000 à 150 000 retours à l’emploi dans un contexte de pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs.
Des études économiques, notamment l’ouvrage Améliorer l’assurance-chômage publié en 2014 par les économistes Stéphane Carcillo et Pierre Cahuc (Presses de Sciences Po), montrent d’ailleurs que les demandeurs d’emploi intensifient leurs recherches d’emploi en fin de période d’indemnisation. Quand on compare, en outre, le taux de remplacement, qui rapporte l’indemnisation chômage au salaire net du dernier emploi de l’assuré, nous constatons également que le système français est très généreux par rapport aux autres pays de l’OCDE.
Inefficace face aux problèmes d’appariement
Cependant, cette réforme ne prend pas en compte deux problèmes : le premier concerne les spécificités territoriales. En effet, si l’on compare les taux de croissance annuels moyens du PIB par habitant entre 2000 et 2018 de la région Île-de-France et de la région Grand-Est, on constate qu’ils sont respectivement de 1,04 % et 0,19 % selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Les différentes dynamiques économiques entraînent donc des difficultés différentes en matière de retour à l’emploi. Pourtant, la réforme doit s’appliquer partout de la même manière.
Mais il n’y a pas que les régions que cette réforme semble confondre. À englober tous les chômeurs dans une même catégorie, mélangeant les parcours, les qualifications et les types d’emploi, le texte ne tient pas compte d’un second problème : ce que les économistes appellent le chômage d’appariement.
On désigne par là une situation où l’on observe un taux de chômage important alors qu’il y a beaucoup d’emplois vacants. Ce décalage s’explique par une inadéquation entre les qualifications des demandeurs d’emploi et les emplois proposés par les employeurs. De ce fait, en période de croissance économique et face à un chômage d’appariement, un individu en recherche d’emploi ne bénéficierait pas du temps nécessaire pour trouver un poste en adéquation avec ces qualifications ou se former. Or, toucher une allocation, c’est pouvoir prendre le temps de se former, surtout pour les plus précaires qui ont besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour répondre au besoin du marché du travail et qui n’ont pas pu mettre de l’argent de côté auparavant.
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Pour l’observer, les économistes disposent d’un outil en particulier : la courbe de Beveridge qui décrit la relation, décroissante, entre le taux d’emplois vacants et le taux de chômage. En période de croissance économique, la demande de travail augmente, ce qui accroît le taux d’emplois vacants et favorise la baisse du taux de chômage. A contrario, en période de récession, la demande de travail baisse, entraînant avec elle le nombre d’emplois vacants. On observe alors une hausse du chômage.
On peut mesurer le degré d’appariement sur le marché du travail en fonction du positionnement de la courbe de Beveridge par rapport à l’origine. Plus la courbe est proche de l’origine, moins il y a de chômage d’appariement. En France, la baisse du taux de chômage s’opère en fait dans un contexte d’augmentation du taux d’emplois vacants, ce qui prouve que le chômage d’appariement est important.
Or, la solution face aux problématiques d’appariement est souvent la formation pour permettre aux demandeurs d’emploi de satisfaire les besoins des employeurs. Et de ce point de vue, la réforme peut sembler assez inefficace.
Pour les plus précaires, plus le temps de se former
Quand on compare le taux de chômage en fonction des qualifications professionnelles, on constate que les employés au niveau bac+2 ont un taux de chômage très bas depuis 2015, aux alentours de 5,3 % en 2021, alors qu’il est de 8,5 % pour les employés niveau bac ou certificat d’aptitude professionnelle (CAP), et 14,4 % à un niveau brevet des collèges ou sans qualifications.
Pour les moins qualifiés, la réforme porte le risque de la précarisation de leur situation. En effet, il s’agit de la catégorie qui occupe le plus les emplois à temps partiel, en partie involontaire. Cette réforme pourrait donc creuser les inégalités en créant une trappe à sous-qualification et grossir le « halo du chômage » (inactifs n’étant pas au chômage mais dans une situation qui s’en approche) : les assurés en fin de droit se verraient obliger d’accepter un emploi sous peine de perdre leurs revenus ; il serait alors plus difficile de trouver le temps de bénéficier d’une formation adéquate pour augmenter leur niveau de qualification et donc sortir de ce schéma.
En période de croissance économique, le temps que pourra consacrer le demandeur d’emploi pour se former ou se reconvertir sera donc réduit… sauf a priori pour les plus qualifiés. En effet, selon la théorie du capital humain énoncée par le prix « Nobel » d’économie américain Gary Becker en 1964, le revenu augmente avec le niveau de qualification car plus ce capital, qui correspond plus ou moins à son niveau d’éducation, est important chez un individu, plus ce dernier est productif et plus son revenu augmente.
En outre, comme le soulignait l’économiste britannique John Maynard Keynes, plus le revenu d’un individu augmente, plus la part de son revenu épargné augmente. Or, cette épargne en période de chômage peut constituer un complément à l’assurance-chômage qui permet de financer la recherche d’un nouvel emploi tout en se formant. Autrement dit, plus on touchait un salaire élevé avant d’être au chômage, plus on a de l’argent de côté, et plus on peut les utiliser pour se former une fois sans emploi.
Selon un rapport de l’Unedic publié récemment, ce sont d’ailleurs les plus diplômés des allocataires de l’assurance-chômage qui suivent une formation. 58 % ont au moins un niveau bac, contre 46 % de l’ensemble des allocataires.
Et l’objectif financier ?
En résumé, la réforme envisagée par le gouvernement va inciter à retrouver un emploi le plus vite possible, avec pour risque que les chômeurs les plus précaires acceptent des emplois nécessitant des qualifications faibles. Un hiatus peut alors apparaître : cette réforme risque de réduire les qualifications des chômeurs qui n’ont pas des emplois hautement qualifiés et d’accentuer la polarisation sur le marché du travail.
Or, si le capital humain des individus se détériore dans une économie, c’est la croissance de long terme qui est en jeu, ce qui interroge in fine l’objectif financier de la réforme.
Pour que cette réforme soit juste, il ne faudrait ainsi à nos yeux pas toucher à la durée d’indemnisation mais plutôt accompagner et conditionner l’assurance-chômage à un suivi de formation pour un meilleur retour à l’emploi, comme c’est le cas au Danemark au bout de neuf mois de chômage. Les autorités devraient en outre considérer les contraintes géographiques car la mobilité limitée des travailleurs peut impliquer l’existence de déséquilibres locaux du marché du travail. Il s’agit enfin de s’interroger sur le défaut d’attractivité de certains métiers dans lesquels les conditions de travail ou de salaire sont trop dégradées font fuir les candidats.
Bernard Laurent, Professeur, EM Lyon et Kévin Parmas, Instructeur d’économie, EM Lyon
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.